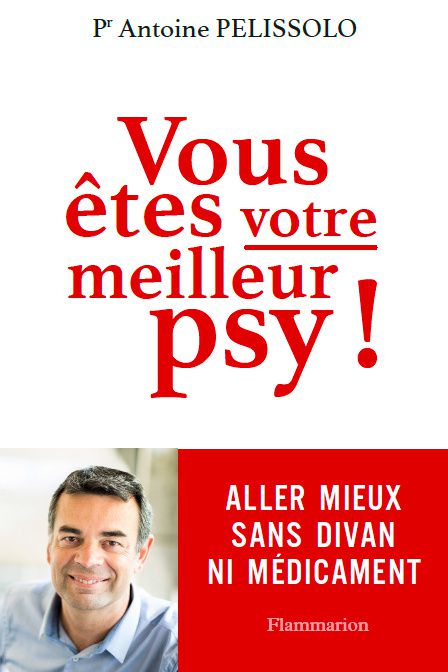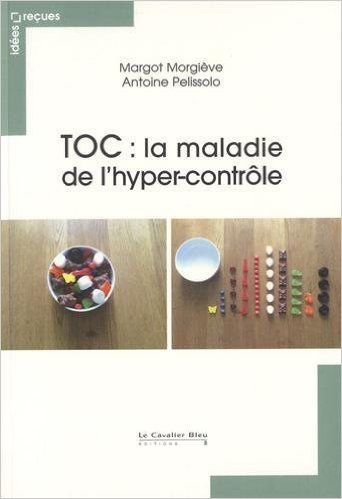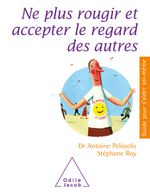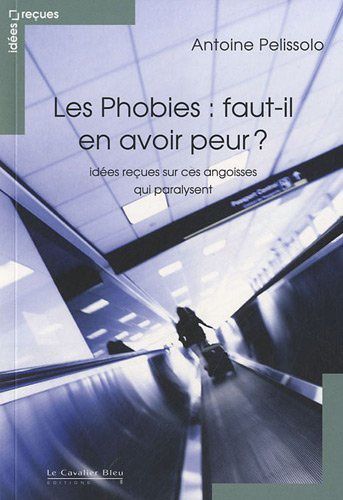Quoi de plus mystérieux et déconcertant que l’effet placebo, aussi bien pour un médecin que pour un malade ? Aller mieux, voire guérir complètement, sans rien de biologique ni aucune intervention physique directe, reste très troublant. Et cela dans des affections aussi diverses que les rhumatismes, la dépression, des infections virales, l’hypertension artérielle, et beaucoup d’autres. L’administration d’un placebo d’EPO à des sportifs leur permet même de courir plus vite ![1]
Dans nos cabinets et entre médecins, l’allusion à l’effet placebo a toujours une connotation négative : « Ce médicament n’est qu’un placebo », ou « Ce patient est très sensible à l’effet placebo ». Sous-entendu : malade imaginaire… Au plan scientifique, des recherches neurobiologiques ou en imagerie cérébrale récentes ont cependant un peu réhabilité l’effet placebo en montrant par exemple que des modifications biochimiques bien réelles accompagnent le soulagement d’une douleur lors de l’administration d’une substance neutre[2], c’est-à-dire d’un placebo. Comme si, seule, une confirmation physique pouvait être sérieuse et crédible.
De fait, comme le rappelle l’étymologie du terme (« Je plairais »), le placebo agit avant tout dans la tête. Parce que le médecin a été très convaincant en le prescrivant, ou pour toute autre raison conduisant le patient à investir beaucoup de confiance dans le traitement qu’il reçoit (un ami qui en a bénéficié, une tradition familiale ou régionale, etc.), l’effet thérapeutique peut être total. Ceci ne veut pas forcément dire qu’aucune action biologique n'est à l’œuvre : un effet partiel ou sur certains symptômes (douleurs, transit intestinal, sommeil, etc.) peut induire une première satisfaction favorisant la confiance et donc un effet placebo actif sur d’autres processus, dans un cercle vertueux s’opposant au cercle vicieux de la maladie. Nous avons là une démonstration nette des « pouvoirs de l’esprit » ou, plus prosaïquement, des liens aujourd’hui évidents entre l’esprit et le corps, pour le pire (la maladie) comme pour le meilleur (la guérison). Bien sûr, toutes les affections ne sont pas complètement accessibles à ces processus d’auto-traitement, surtout quand des dérèglements physiques stables sont à la base de la pathologie comme dans la maladie d’Alzheimer, les cancers ou une hémorragie digestive. Mais la recherche médicale dévoile tous les jours un peu plus le rôle délétère du stress dans beaucoup de mécanismes biologiques, au travers des systèmes immunitaires et de l’inflammation. Ceci concerne presque tous les organes et en particulier le cœur, les vaisseaux, la peau, l’estomac, les intestins, et le cerveau. Rien d’étonnant alors qu’une souffrance psychologique puisse se répercuter sur ces organes sensibles, et qu’une réduction du stress atténue les symptômes qui en dépendent.
L’effet placebo est, d’une certaine manière, le premier degré d’une psychothérapie : l’attente positive mobilise les ressources d’auto-guérison et réduit les facteurs de stress. Mais cette action est très aléatoire puisqu’elle échappe au contrôle direct et à une compréhension fine de ses mécanismes par la personne elle-même. Dans les symptômes sévères et chroniques, l’effet placebo est d’ailleurs assez imprévisible, et en général peu durable. Il se rapproche des résultats de l’hypnose, favorables chez certains patients mais de manière aléatoire et généralement fugace. L’auto-persuasion a donc des limites, alors qu’une psychothérapie réelle, basée sur un travail en profondeur et sur la durée, peut augmenter les ressources et les défenses personnelles face au stress. On en attend habituellement un bien-être psychologique et une amélioration des troubles psychiques, mais l’impact peut être également physique, sur les symptômes liés au stress. Et cela de manière plus construite et plus satisfaisante qu’avec un placebo seul. L’énergie à y mettre et les prix sont souvent plus importants, mais certaines méthodes pseudo-thérapeutiques sont parfois aussi très coûteuses…
Texte extrait de "Retrouver l'espoir. Abécédaire de psychiatrie positive" (Antoine Pelissolo, Odile Jacob)